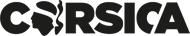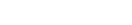Rechercher...
La destination Corse
Préparer mon séjour
Une histoire forte et tourmentée
Certains hommes, comme Napoléon Bonaparte, Pascal Paoli ou Sampiero Corso ont même changé, chacun à sa manière, l’histoire de la France ou du monde.
La préhistoire
La Corse est certainement occupée par des groupes peu nombreux à partir du VIIe millénaire avant Jésus-Christ. Le premier être humain connu est "la dame de Bonifacio" (vers 6570 av. J.C.). Au néolithique, l’homme occupe entièrement l’île, agriculture et élevage se développent et des villages s’organisent. Des rapports réguliers avec les côtes méditerranéennes les plus proches sont certains. Une civilisation brillante se construit au IIIe millénaire. Elle sait fondre le cuivre, sculpte des centaines de menhirs qui sont parfois de véritables statues, et bâtit des constructions en énormes pierres (castelli, torri). Tout indique une société organisée, très proche de celle de la Sardaigne nuragique.
L'antiquité
La Corse entre dans l’Histoire quand y débarquent des Grecs de Phocée, en 565 av.J.C. Implantés à Aleria (Alalia), ils comptent y fonder leur principal centre en Occident. Ils sont vainqueurs en 540 de leurs voisins coalisés, Etrusques et Carthaginois, mais avec de si lourdes pertes qu’ils abandonnent en partie leur colonie. Aleria demeure un grand centre où cohabitent populations venues de l’extérieur et Corses " barbares ". Ceux-ci conservent leur mode de vie mais ont des liens avec les grandes puissances, auxquelles ils fournissent des mercenaires. La situation stratégique de l’île et l’utilité de ses forêts pour la construction navale en font un enjeu des guerres puniques. La conquête romaine finit par vaincre les dernières résistances en 111. Elle est suivie de l’implantation de colonies, à Mariana et Aleria. Tandis que de nouveaux arrivants s’installent en Corse, on trouve des Corses dans tout l’Empire. L’île est rapidement christianisée, du moins sur les côtes
Le Moyen-Age
Après des invasions successives, la Corse est défendue contre les Maures par les rois francs et leurs vassaux de Toscane. Les féodaux de l’île prennent parti dans l’affrontement entre les républiques de Gênes et de Pise. Après la domination pisane, qui laisse le souvenir d’une ère de paix et de développement artistique et culturel, Gênes s’impose. Le XIVe siècle est une époque de bouillonnement, avec l’hérésie des Giovannali, puis une révolution anti-féodale en 1358, sous la direction de Sambucucciu d’Alandu. Menacée d’un retour des seigneurs, la Commune de Corse " se donne " par contrat à Gênes, alors très grande puissance méditerranéenne. L’île est divisée pour longtemps entre un Sud féodal et un Nord plus démocratique. Gênes met des siècles à s’imposer face aux seigneurs cinarchesi qui rêvent de créer un Etat corse avec des appuis extérieurs. Ce n’est qu’au début du XVIe qu’elle en vient à bout, après des destructions qui ont vidé une partie du pays. Dans cette période, Gênes, qui contrôle Bonifacio depuis 1195, construit les villes actuelles, peuplées d’abord de ses seuls colons, et se fixe un programme de mise en valeur. Si une certaine prospérité semble présente, les rêves de libération qui persistent donnent un sens patriotique corse à l’occupation française en 1553, avec l’aide du condottiere Sampieru Corsu. Quand Gênes récupère l’île, Sampieru reprend la lutte, jusqu’à sa mort glorieuse qui en fait un symbole.
La Paix Génoise
Gênes contrôle la Corse sans opposition pendant cent cinquante ans. C’est l’époque où commencent les grandes razzias barbaresques, qui ruinent des régions entières et entraînent la construction du réseau de tours littorales. Le " long XVIIe siècle " (1567 à 1729) est marqué par une poussée démographique, et un développement agricole et commercial. L’éducation progresse et une couche de notables ruraux se constitue. La Corse du XVIIIe est sujette d’une république épuisée, dont elle est la dernière colonie. Une élite influencée par les Lumières proteste contre l’inefficacité du système génois. La révolution, qui commence comme révolte contre l’impôt, se structure progressivement. Aucun des deux camps ne peut obtenir seul de victoire militaire. Les insurgés se donnent un système étatique, avec sa constitution, son hymne et son drapeau : d’abord sous le roi allemand Théodore de Neuhoff, puis dans le cadre du régime que dirige Pasquale Paoli à partir de 1755. Celui-ci établit un pouvoir démocratique stable, qui contrôle presque tout le territoire, et lance une politique de développement économique (création d’une flotte et du port de l’Ile-Rousse) et culturel (création de l’Université). Il met fin aux excès de la vendetta traditionnelle et répand la notion d’intérêt public. La Constitution de 1755, qui affirme le droit des peuples à la liberté, apparaît comme un modèle à travers le monde.
La Révolution et le Royaume Anglo-Corse
Incapable de reconquérir l’île, Gênes la cède à la France le 15 mai 1768. Depuis longtemps, la monarchie française cherche à contrôler la Corse dans un but stratégique. La bataille de Ponte Novu en 1769 brise la résistance organisée. Paoli s’exile en Angleterre, tandis que la guérilla se poursuit jusqu’en 1774. La Corse, replongée dans l’Ancien Régime, sert de lieu d’expérience pour des innovations prévues pour l’ensemble du Royaume. Les jeunes gens des familles notables font leurs études en France, tandis que l’île est privée de ses lieux de formation ; l’aggravation des impôts et l’inféodation de terres communes exaspèrent la population. La Révolution de 1789 est comprise par les Corses comme un ralliement de la France aux idées qu’ils défendaient vingt ans plus tôt. C’est dans l’enthousiasme que l’île est intégrée dans “l’Empire français" le 30 novembre 1789, tandis que Paoli reçoit un accueil triomphal et retrouve le pouvoir. Mais les oppositions ne tardent pas : Paoli, accusé de l’échec de l’expédition de Sardaigne et convoqué à la Convention, fait appel à l’Angleterre. Le 10 juin 1794 est proclamé le royaume anglo-corse : l’île, dont le roi est celui d’Angleterre, dispose de sa propre constitution. Cette expérience dure deux ans : un nouvel exil de Paoli et les succès de Bonaparte en Italie facilitent la reconquête française dès 1796.
XIX ième et XX ième siècles
Malgré quelques tentatives de développement, l’Empire est surtout un moment de répression. Dans la suite du XIXe siècle se structure le système des " clans " : deux partis, regroupant des groupes villageois, affichent pour la forme un engagement politique. Le banditisme atteint son paroxysme, et l’île se replie sur elle-même malgré les progrès des transports. Des sociétés secrètes manifestent encore l’attachement de nombreux Corses à une Italie en révolution. Ce n’est que sous le second Empire, qui offre des carrières à l’extérieur, que les Corses s’intègrent à l’ensemble français. Le XIXe siècle connaît une croissance démographique (jusqu’à 340 000 habitants), sans développement économique correspondant. Des départs massifs commencent vers la France et ses colonies, et vers l’Amérique latine. L’île, misérable et surpeuplée par rapport à ses ressources, reçoit de la guerre de 1914 un coup terrible : 12000 morts et de nombreux départs. Ce désastre développe un premier nationalisme, exprimé par la revue A Muvra. Le rapprochement de ce courant avec le fascisme italien le discrédite. Occupée par les Italiens en novembre 1942, la Corse fait le choix de la France et, sous direction communiste, se libère en septembre 1943.